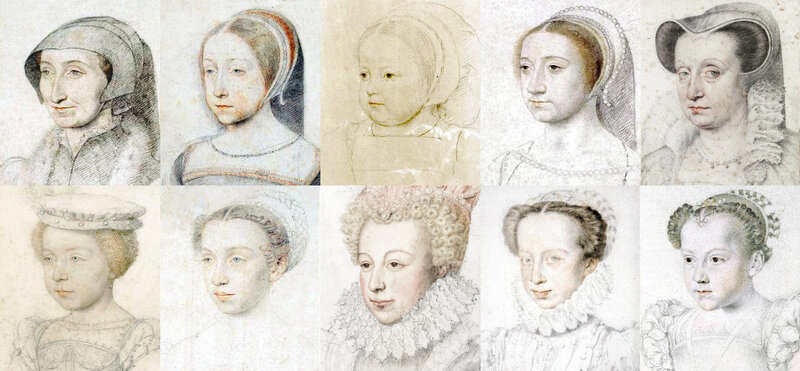7 janvier 2021
Diane de France (1538-1619)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F91%2F291893%2F21849679_o.jpg)
Portrait en buste d'une petite fille par le peintre Corneille de Lyon Source de l'image : Christies (Vente du 15 septembre 2020 à Paris) Diane est la fille naturelle d'Henri II et d'une piémontaise nommée Filippa Duci. A sa naissance en 1538, son père...



/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F38%2F08%2F291893%2F42371253_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F21%2F291893%2F94129965_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F84%2F291893%2F57165410_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F17%2F291893%2F22345330_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F40%2F291893%2F22344273_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F37%2F69%2F291893%2F50514127_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F75%2F291893%2F47804143_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F30%2F291893%2F44981362_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F93%2F291893%2F40118602_o.jpg)