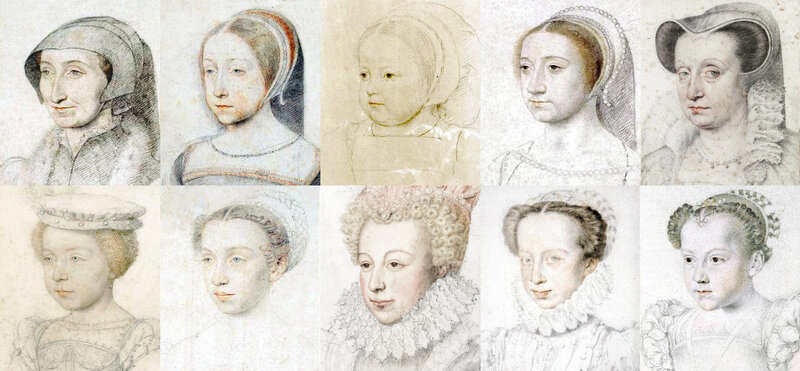19 septembre 2022
Autres représentations
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F06%2F291893%2F128922445_o.jpg)
Portraits gravés du roi en armure Source et localisation : Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France) ; Gallica ; Gallica ; Gallica Portraits gravés en médaille Source et localisation : (Londres, British museum) ; (Londres, British museum) ; (Londres,...



/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F51%2F291893%2F128720863_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F34%2F291893%2F12954824_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F41%2F14%2F291893%2F58738224_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F38%2F56%2F291893%2F123296278_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F45%2F291893%2F124581389_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F29%2F87%2F291893%2F121349406_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F58%2F291893%2F12766363_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F51%2F291893%2F128905709_o.jpg)